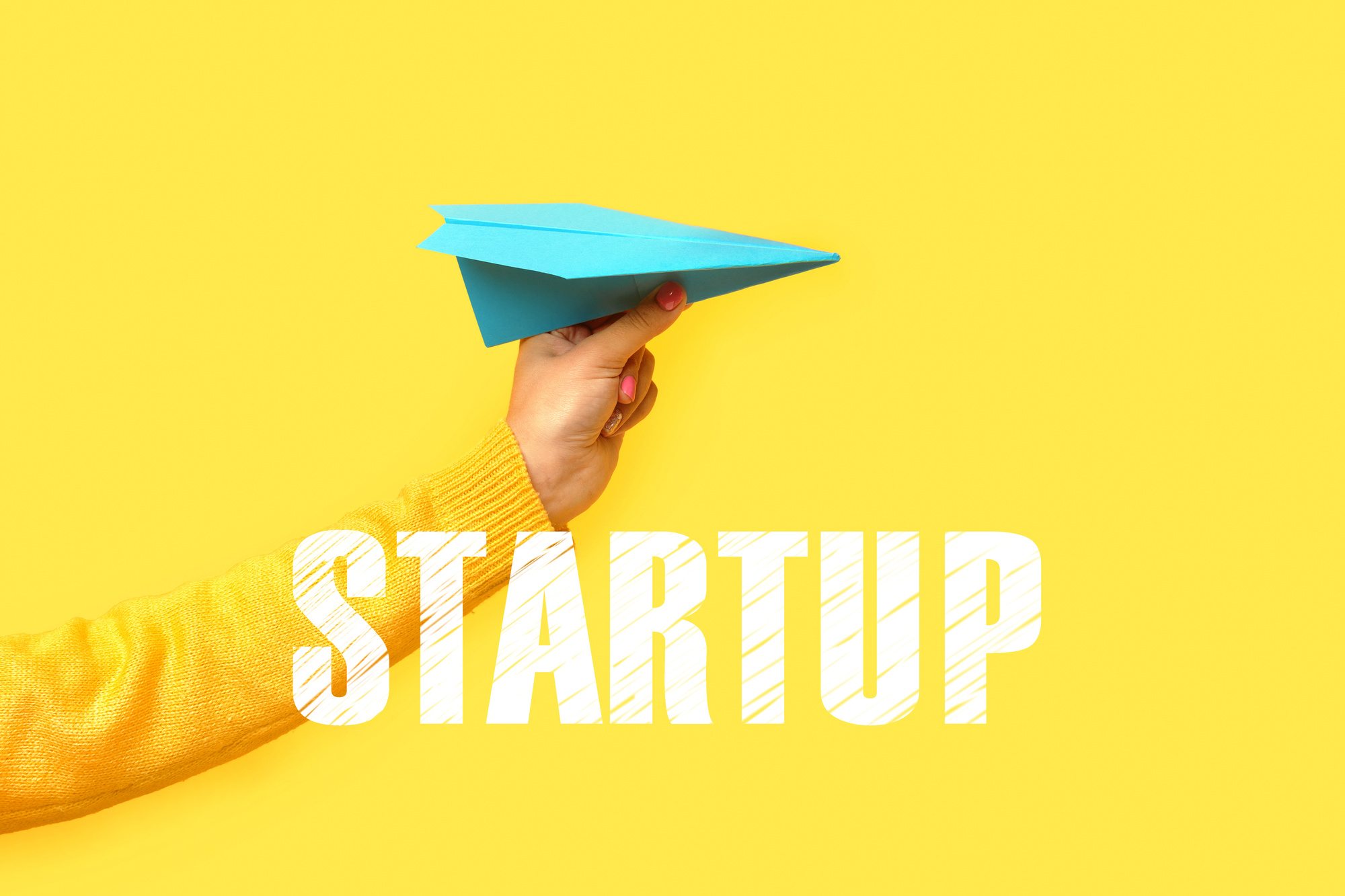Cela fait plusieurs années maintenant que le modèle de la start-up fait partie intégrante du monde de l’entreprise. Pourtant, le terme reste encore flou pour beaucoup. Est-ce qu’il s’agit uniquement d’une jeune entreprise ou la structure est-elle totalement différente d’une entreprise traditionnelle ? Parce que dans le fond, une start-up est bien une société comme les autres. Elle a un statut juridique, elle recrute des salariés, elle paye des impôts et elle suit les mêmes règles que toutes les entreprises.
Pourtant, la définition d’une start-up ne se limite pas à sa création ni à son capital social. En effet, elle se distingue surtout par son plan de développement, mais aussi par sa gestion, son modèle économique et son objectif de croissance (rapide) et d’innovation.
Si vous réfléchissez à un projet, il peut être judicieux de comprendre ces différences pour peut-être choisir ce statut avec tout ce qu’il implique (y compris en matière de risques). Je vous propose donc de faire le point sur ce qui oppose une start-up à une entreprise classique.
La start-up : une définition qui dépasse le cadre juridique
Techniquement, une start-up est une jeune société innovante qui vise un développement rapide sur un marché le plus souvent novateur. Néanmoins, en France, la création d’une start-up passe tout de même par un statut juridique classique, comme une SAS ou une SARL. Elle doit être immatriculée, définir son capital social, avoir rédigé des statuts et se soumettre aux mêmes obligations juridiques qu’une autre entreprise. C’est donc bien sa recherche d’innovation et son plan de croissance qui en font sa caractéristique différenciante.
Là où une entreprise classique s’installe sur un marché existant, adopte un modèle de business éprouvé et cherche la rentabilité avant tout, une start-up part souvent d’une idée nouvelle, d’un produit innovant ou d’un service inédit, parfois même en phase expérimentale. Cette dernière teste son modèle économique, cherche à attirer des investisseurs et doit faire face à un risque élevé. C’est d’ailleurs pour cette raison que les start-ups sont souvent associées à des secteurs innovants comme la tech, la santé ou la recherche.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une start-up n’a pas encore trouvé son équilibre financier. Le principe même de son existence est de brûler du capital pour accélérer sa mise sur le marché, recruter des salariés rapidement et espérer transformer une idée en une activité rentable. Et c’est cette phase jeune et un peu instable qui la distingue d’une société plus mature, où la gestion est bien plus structurée et la responsabilité sociale mieux définie.

Selon une étude de Startup Genome, le taux d’échec des startups à cinq ans est de 90 %.
La structure de la start-up est pensée pour une croissance rapide
Comme je viens de l’évoquer rapidement, la structure d’une start-up est conçue pour la croissance. Elle fonctionne définitivement comme un projet évolutif, où chaque décision vise à faire grandir rapidement l’activité. Cette raison d’être explique d’ailleurs que l’on retrouve souvent des sociétés par actions simplifiées (SAS) dans ce milieu, parce qu’il s’agit d’un statut juridique flexible très apprécié des investisseurs. La SAS permet en effet d’émettre des actions, de faire des levées très intéressantes auprès de fonds de capital-risque et de redistribuer des parts simplement.
À l’inverse d’une SARL, qui convient beaucoup mieux à des sociétés familiales ou locales, une SAS favorise l’entrée de capitaux et la mise en place de plans de stock-options pour attirer les jeunes talents. Or, une telle souplesse juridique est capitale dans un contexte où le développement se joue à l’échelle du marché international et où le temps est compté.
Et puis, une start-up ne se contente pas de créer un produit ou un service. En vérité, elle conçoit un modèle d’affaires capable d’évoluer rapidement, c’est-à-dire de générer des revenus exponentiels sans multiplier les coûts de travail ou de gestion. C’est exactement ce qui différencie une structure innovante d’une société classique où chaque nouvelle activité entraîne plus de charges sociales, plus de salariés et plus de contraintes.
De manière générale, le plan de développement d’une start-up est uniquement pensé pour séduire les investisseurs. Il repose d’ailleurs sur de nombreux indicateurs, à l’image :
- du taux de croissance ;
- des précédentes levées de fonds ;
- des parts de marché conquises ;
- etc.
C’est une approche bien différente d’une entreprise plus classique qui préfère axer sa stratégie sur des profits réguliers et une gestion stable.
Le rôle du financement et des investisseurs dans la survie des start-ups
Vous l’aurez compris, le financement est le nerf de la guerre lorsqu’il s’agit d’une startup. Et pour cause, puisqu’elle démarre rarement sur fonds propres. Toute sa survie repose sur des levées de fonds auprès de business angels [insérer un lien vers l’article business angels publié quelques jours avant], de fonds d’investissement ou via des aides à l’innovation. Les investisseurs injectent des euros sonnants et trébuchants en échange de parts sociales ou d’actions, dans l’idée d’un retour sur investissement maximal en cas de succès. Il faut être bien conscient qu’une startup peut vivre plusieurs années sans faire de bénéfices, en étant totalement dépendante du capital-risque et des subventions qu’elle perçoit.
De son côté, l’entreprise traditionnelle (SARL, SAS, etc.) finance le plus souvent sa création grâce à un apport personnel, un prêt bancaire ou un simple réinvestissement de ses bénéfices. Son plan de financement est beaucoup plus linéaire et le risque y est bien moindre.
Le modèle de la startup repose donc sur une forte responsabilité, car il faut convaincre des investisseurs de soutenir l’idée, tout en démontrant que le produit ou le service peut réellement conquérir un marché. C’est aussi ce qui attire des profils d’entrepreneurs jeunes et ambitieux, prêts à travailler sur des projets innovants avec des perspectives de croissance fulgurante, sans compter leurs heures, même si la prise de risque est importante.
Pour faire simple, le modèle startup est indissociable de cette logique de levées de fonds et de développement rapide, ce qui ne correspond pas à toutes les sociétés ni à tous les secteurs. Ce n’est finalement qu’une jeune société qui mise sur l’innovation, une croissance rapide et des financements extérieurs massifs. Là où une entreprise traditionnelle privilégie la stabilité et une gestion prudente, une startup accepte un risque élevé pour transformer une idée innovante en activité nationale, voire internationale.